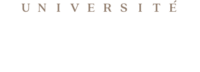Massivement adopté dans le royaume, le smartphone est utilisé par les Saoudiennes de multiples façons, souvent pour étendre leur marge de manœuvre dans une société où, malgré de récentes avancées, leurs droits restent nettement inférieurs à ceux des hommes. Si l’objet constitue un vecteur d’« empowerment », il est aussi un instrument de surveillance.
En janvier 2019, l’affaire Rahaf Mohammed al-Qunun fit le tour du monde : cette jeune Saoudienne qui cherchait à fuir sa famille se retrouva immobilisée en Thaïlande, son passeport confisqué. Munie de son smartphone, elle utilisa les réseaux sociaux pour alerter les organisations internationales sur le sort qui l’attendait. Le Canada accepta finalement sa demande d’asile. Le chargé d’affaires saoudien en Thaïlande déclara alors que les autorités auraient mieux fait de la priver de son téléphone, révélant ainsi le pouvoir inédit de cet objet connecté.
La même année, la militante Manal al-Sharif, connue pour avoir cofondé le mouvement Women to Drive en 2011 et l’avoir popularisé sur les réseaux sociaux, ferma ses comptes Twitter et Facebook. Ces outils, qui lui avaient d’abord permis de libérer sa parole, étaient devenus un piège au service de la propagande saoudienne et de la désinformation. Instruments de résistance et de mobilisation féministe résonnant auprès du monde entier, les réseaux sociaux se révélèrent des armes oppressives.
À la fin des années 2010, de nombreuses Saoudiennes se servaient des réseaux sociaux pour développer leur entreprise ou leur business.
Ces exemples reflètent la grande diversité de la condition de la femme en Arabie saoudite – une condition qui ne saurait se réduire à la représentation stéréotypée de la femme musulmane victimisée, soumise ou, à l’inverse, de la femme entrepreneuse glamour et cosmopolite. Ils traduisent également le rôle que peut jouer le smartphone dans la négociation avec les normes de genre.
Alliant conservatisme religieux et avant-gardisme technologique, le royaume se hisse parmi les nations les plus connectées de la planète, se distinguant par des taux de pénétration record en matière de microblogging et de réseaux sociaux comme YouTube. Introduit dans les années 2000, le smartphone s’est très rapidement implanté dans cette société qui a fait de la numérisation et de l’investissement dans la tech l’un de ses nouveaux étendards politiques.
La ségrégation de genre instituée…
Façonnée par des dimensions historiques, culturelles, religieuses et économiques, l’identité de la femme saoudienne est plus complexe que celle véhiculée par l’Occident, qui voit en elle une subordonnée.
Il est vrai que l’héritage tribal et la doctrine wahhabite, dominants dans le pays, ont longtemps fixé un cadre rigoriste qui a façonné la place des femmes dans la société. Mais paradoxalement, c’est le boom pétrolier des années 1970 qui a renforcé et institutionnalisé la ségrégation de genre, constituant à la fois un obstacle et un levier à l’émancipation des femmes.
Toutefois, dans les années 2000, des réformes progressives ont eu lieu : depuis 2014, les Saoudiennes peuvent travailler dans de nombreux secteurs sans l’accord de leur tuteur ; depuis 2018, elles peuvent ouvrir leur propre entreprise et conduire sans cette autorisation préalable ; et depuis 2019, les femmes peuvent voyager sans accord tutélaire. Le plan Vision 2030 a du reste accéléré ce mouvement en inscrivant la libéralisation économique et sociale au cœur du projet politique saoudien.
La société reste néanmoins sexiste et hiérarchisée, avec des rapports de genre s’inscrivant dans un système patriarcal où l’homme détient l’autorité et définit l’honneur féminin comme un bien à protéger. Cette hiérarchie se manifeste dans la famille, l’espace public, la loi ou encore la langue, qui consacre la domination masculine.
C’est dans ce contexte d’une société ségrégationniste, où les Saoudiennes ont longtemps été assignées à la sphère domestique, mais aussi de réformes en faveur des droits des femmes, que le smartphone exerce un rôle polyvalent et paradoxal.
Les normes de genre ébranlées par le smartphone
Les Saoudiennes se sont rapidement approprié l’internet et, plus encore, le smartphone. Initialement plus connectées que les hommes – elles étaient 96 % à utiliser l’internet en 2015, contre 88 % pour les hommes (selon la Commission des Technologies de l’Information et de la Communications, devenue Commission de l’espace et de la technologie Space and Technology Commission) –, les Saoudiennes passaient aussi plus de temps en ligne, et se connectaient davantage depuis leur domicile et via leur smartphone. Ces pratiques s’expliquaient à la fois par la construction statutaire de l’identité de genre, qui les confinait à l’espace domestique, et par l’interdiction de conduire, laquelle contribuait à renforcer leur usage du smartphone.
Loin d’être un simple outil technique, le smartphone a dès lors été investi comme support de visibilité et d’expression de soi pour compenser une invisibilité engendrée par la ségrégation de genre.
Toujours à portée de main, le smartphone s’est aussi imposé comme un accessoire de mode, éminemment visible pour les Saoudiennes vêtues d’abāya et de niqāb, une visibilité d’autant plus marquée avant la déclaration en 2018 du prince héritier Mohammed Ben Salmane, homme fort du royaume, déclaration selon laquelle le port de l’abāya n’était pas obligatoire.
Dans cette société stratifiée où les objets ont un pouvoir distinctif – un iPhone dernier cri est un marqueur social et esthétique –, le smartphone devient une parure ostentatoire, un instrument de stylisation et de présentation de soi qui s’exhibe dans les espaces publics, en particulier dans les centres commerciaux où les femmes peuvent déambuler en confiance.
Au-delà de son rôle symbolique, le smartphone a ouvert un espace d’émancipation grâce à la photographie et aux réseaux sociaux, alors même que l’image humaine est controversée dans l’islam et que les photographies furent longtemps proscrites en Arabie saoudite, le pays étant allé jusqu’à bannir les premiers téléphones munis d’appareils photos. Ces interdictions ont progressivement cédé, en dépit de restrictions persistantes.
En 2016, l’essor de Snapchat joua un rôle décisif. Très populaire en Arabie saoudite – le royaume figurait parmi les premiers utilisateurs au monde –, l’application permit aux jeunes femmes de se rendre visibles à travers des selfies et portraits retouchés. Les filtres constituaient autant de stratégies pour contourner la censure islamique, un portrait ou un corps modifié n’étant plus considéré comme une représentation humaine. Ces usages ludiques pouvaient être transgressifs : montrer ses cheveux ou son visage, même transformés, revenant à défier les normes.
Le smartphone a ainsi permis aux Saoudiennes de négocier avec les codes, d’affirmer la présence des femmes dans l’espace numérique et, parfois, de contester l’ordre social établi.
Le smartphone : instrument au service ou contre le féminisme ?
Pour les Saoudiennes, empêchées de conduire jusqu’en 2018, le smartphone devint un instrument de mobilité via les applications de VTC Uber ou Careem, leur permettant de se déplacer sans recourir à un membre masculin de leur famille ou à un chauffeur privé. Les applications de géolocalisation rassuraient quant à elles les proches, facilitant les sorties des jeunes filles.
Au-delà, le smartphone constitue un véritable instrument de militantisme. Le mouvement Women to Drive trouva ainsi une nouvelle ampleur grâce au numérique. En 2013, c’est en effet avec leur mobile connecté que des Saoudiennes, bravant publiquement l’interdiction de conduire, se filmèrent au volant et diffusèrent leurs vidéos sur YouTube et Twitter.
Plus largement, dans ce pays où la scène politique est inexistante, c’est sur les réseaux sociaux que se tiennent les débats et mobilisations féministes. C’est d’autre part grâce au développement de services numériques que les Saoudiennes ont pu s’affranchir de certaines règles du système de tutelle. Ainsi, créée en 2015, l’application gouvernementale Absher a-t-elle pu simplifier le quotidien des femmes, leur ouvrant même la voie pour déjouer le système en s’octroyant elles-mêmes l’autorisation de voyager.
Pourtant, le smartphone peut aussi jouer contre le féminisme. Cette même application Absher, initialement conçue pour faciliter l’ensemble des démarches administratives, a ainsi été dénoncée comme un objet de surveillance renforçant le contrôle sur les femmes. Par ailleurs, instrumentalisés par le régime, les smartphones sont devenus des objets de filature via leur numéro IMEI, permettant de traquer les personnes dissidentes ou des Saoudiennes tentant d’échapper à leur possible funeste destinée.
Outil d’émancipation et d’empowerment, le smartphone en Arabie saoudite est donc aussi un instrument de contrôle. C’est cet objet qui, au-delà des cas de Rahaf Mohammed ou de Manal al-Sharif cités plus haut, a permis à des femmes de développer leur entrepreneuriat sur Instagram, ou à des prédicatrices musulmanes de défendre leurs droits sur la scène numérique en luttant en faveur de la préservation du système de tutelle, considéré par certaines d’entre elles comme un dispositif de protection de la femme saoudienne.
Au service du féminisme – un regard tourné vers l’Orient met du reste au jour la pluralité de ses visages, irréductible à un modèle de résistance calqué sur l’expérience occidentale –, le smartphone en Arabie saoudite peut servir la cause des femmes autant que la desservir. Il a pu ainsi œuvrer contre le féminisme en renforçant le contrôle des voix dissidentes, en développant l’espionnage et la traque, et en consolidant, via les réseaux sociaux, une culture de la surveillance déjà ancrée dans le tissu social. Ni simple outil d’émancipation, ni pur instrument d’oppression, le smartphone demeure un objet et un espace de tensions où se redessinent les rapports de pouvoir et les normes de genre.
Ce texte prend appui sur une communication présentée lors du XXIe congrès de l’Association internationale des sociologues de langue française (AISLF) qui a eu lieu en 2019.
Auteur
Hélène Bourdeloie, Sociologue, maîtresse de conférences en sciences de l’information et de la communication à l’université Sorbonne Paris Nord et chercheuse au LabSIC et associée au Centre Internet et Société (CIS– CNRS), Université Sorbonne Paris Nord
Cet article est republié à partir de The Conversation sous licence Creative Commons. Lire l’article original.