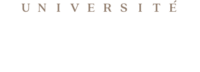Hors du cadre scolaire, immergés dans un milieu naturel, loin de leurs tables et crayons, comment les enfants apprennent-ils et qu’apprennent-ils ? L’expérience des classes de mer nous montre en quoi la confrontation à l’extérieur aide aussi à grandir.
La scène se passe en Bretagne, à la pointe sud du Finistère. « Le phare s’appelle la perdrix », explique l’éducatrice à un groupe d’écoliers en visite dans la région. « Le phare de la perdrix », répète alors un enfant. « Non, “la perdrix”, ce sont les touristes qui disent “le phare de la perdrix” », corrige l’éducatrice. « On est des touristes », insiste l’enfant. « Vous n’êtes pas des touristes, vous êtes en classe de mer », lui explique son interlocutrice. « On est des touristes », réitère l’élève.
Malgré l’insistance de l’éducatrice en milieu marin pour définir la situation, les enfants persistent à se revendiquer en touristes, ce qui dans leur bouche n’est pas négatif. Des entretiens ont permis de comprendre que, pour eux, le tourisme renvoie à la confrontation à quelque chose de différent, d’autre, à la découverte.
Ces propos d’enfants sont issus d’observations et d’entretiens menés dans le cadre d’une recherche sur les classes de mer en Finistère, département où sont nées ces classes de découverte à la suite d’autres plus anciennes, en particulier les classes de neige. Elle a permis de mettre en lumière une expérience de plusieurs décennies souvent oubliée alors qu’aujourd’hui, à la suite de la crise sanitaire due au Covid, est mis en avant l’intérêt de la « classe dehors ».
Que nous apprennent les classes de mer, ces immersions dans un milieu naturel, sur les apprentissages qui s’appuient sur des corps en mouvement, bien loin des corps immobiles de la classe ordinaire ?
Tourisme scolaire et vacances d’école
Ces classes de mer proposent des activités proches pour ne pas dire identiques au tourisme : un déplacement qui implique de vivre le quotidien (en particulier dormir, manger) dans un autre cadre, des activités corporelles (dans notre cas, le nautisme), une découverte de milieux naturels, culturels et sociaux différents mais aussi l’achat de souvenirs, quand c’est autorisé par les enseignants, ou du repos et des jeux, surtout quand le séjour est assez long.
Un enfant a proposé « vacances d’école », belle expression qui évoque à la fois la suspension de l’école et le départ d’une classe pour des « vacances » communes. Bien entendu ce ne sont pas des vacances, les enfants ne s’y trompent pas, mais cela ressemble à des vacances : « Et même quand on travaillait, c’était comme des vacances, c’était comme des jeux. »
Et cela d’autant plus qu’avec des séjours de plus en plus courts, les enseignants mettent en avant les activités propres au lieu, au littoral, limitant les temps de classe. Les investissements que cela implique en organisation, en temps comme un argent, invitent à profiter au maximum du lieu.
Une tension pour une réalité hybride entre classe et loisir
Les enseignants comme les éducateurs attachés au centre nautique où se déroule la classe de mer sont alors pris dans une tension que chacun résout dans un sens ou un autre : rappeler qu’il s’agit de scolaire (« dans classe de mer, il y a classe »), abolir le scolaire au profit d’une expérience autre, spécifique, qui constituera des souvenirs uniques.
Si, parfois, il y a une tentative – souvent vouée à l’échec face à la fatigue des enfants en fin de journée, à l’appel de l’extérieur… – de maintenir la classe, de faire régner la discipline, on trouve plus souvent un abandon à la situation d’autant plus que, dans les centres nautiques visités, elle est riche d’une histoire qui commence en 1964 et qui a produit un ensemble d’activités appréciées des enseignants comme des enfants. Ainsi arrive-t-il à un enseignant de parler de vacances pour, très vite, nous dit-il, expliquer ce qu’est un lapsus aux enfants. Doutons qu’il ait parlé de lapsus révélateur.
Bien entendu si cela ressemble à des vacances, certes très particulières, pour les enfants, ce ne sont pas des vacances pour des enseignants ou des éducateurs chargés de l’organisation. Pas plus que les professionnels du tourisme qui rendent possibles les vacances ne sont eux-mêmes en vacances…
Les caractéristiques de l’expérience des enfants
La classe de mer marque l’expérience d’une autonomie, d’une vie quotidienne sans les parents et, pour beaucoup, c’est le premier séjour en dehors de la famille, cela dans le cadre d’une vie partagée avec ses camarades de classe :
« Moi surtout, ce que j’ai aimé en classe de mer, c’est qu’on pouvait faire des groupes et dormir dans la même chambre. Et que… on pouvait discuter, on pouvait se parler entre nous, et ne pas être seul dans une seule chambre », note un participant.
Se retrouver dans la même chambre que ses copains, copines est sans doute ce qui frappe le plus dans cette expérience, ce qui conduit à de nombreux discours positifs, malgré l’absence des parents. https://www.youtube.com/embed/U5SnaZfegtc?wmode=transparent&start=0 « Les 50 ans des classes de mer » (France 3 Bretagne, 2015).
Avant tout il s’agit de l’expérience d’une nouvelle forme de sociabilité extérieure à la famille, qui conduit nombre d’enfants à relever des apprentissages autour de l’idée de grandir, d’être capable de s’occuper de soi-même, de se préparer à être adulte, de devenir plus autonome.
Les expériences nautiques, la découverte de la voile ou du kayak constituent des moments importants, racontés par les enfants avec nombre de détails. Ils n’oublient pas pour autant la découverte de la flore et de la faune locale, celle, variable selon les séjours, du monde social et culturel (activités de pêche, musées thématiques).
Ainsi des enfants ont pu être particulièrement marqués par la visite d’une criée, ou celle d’un cimetière à bateaux militaires. Et la découverte est également présente pour les enfants bretons ; comme le dit un enfant, en se promenant sur l’estran avec ses parents, il ne pouvait imaginer qu’il s’agissait d’un espace de vie marqué par la présence d’une telle variété d’espèces animales.
Apprendre autrement
Il en résulte un sentiment d’apprendre très fort chez ces enfants. Nous l’avons évoqué ci-dessus concernant une vie quotidienne plus autonome, il renvoie tout autant aux apprentissages corporels et sportifs (le nautisme), la découverte de la faune et de la flore.
Dans le même temps, les enfants soulignent que les objets et les modalités d’apprentissage sont différents. On apprend en s’amusant, parfois sans s’en rendre compte, certains parlent d’apprentissage ludique ce qui conduit à un débat sur la possibilité d’en faire une modalité dominante ou, au contraire, marginale car cela ne permettrait pas d’atteindre les objectifs scolaires légitimes. Il s’agit d’apprentissages qui s’appuient sur l’immersion (« Notre salle de classe, c’est le chemin », dit un éducateur), le corps devenant le moyen d’accéder aux connaissances.
Ce n’est sans doute qu’une parenthèse, relativement courte, les séjours se limitant à cinq voire quatre jours le plus souvent, les plus longs dépassant rarement dix jours. Mais cette parenthèse semble confronter les enfants à un mode d’apprentissage non scolaire ou faiblement scolarisés. Nous avons montré par ailleurs comment le tourisme est un espace d’apprentissage informel (sans intention éducative). Ici, il y a bien intention éducative, mais avec les mêmes modalités, celles de la découverte, du faire, de l’activité et c’est sans doute ce qui fait la richesse de cette expérience pour les enfants, avec, en conséquence, le regret que ce ne soit pas l’occasion d’une réflexion avec eux sur l’apprentissage et ses modalités diverses.
Auteur
Gilles Brougère, Professeur émérite en sciences de l’éducation, Université Sorbonne Paris Nord
Cet article est republié à partir de The Conversation sous licence Creative Commons. Lire l’article original.